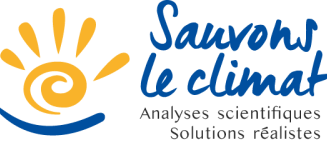| Trop de prévisions irréalistes sans cohérence globale et contraires à la décarbonation du pays par l’électrification des usages, aux lourdes conséquences stratégiques et financières. |
Une consultation publique conduite par la CNDP portant sur la PPE3 et la SNBC3 a été organisée fin 2024 par le gouvernement. Elle a recueilli un taux de réponses exceptionnel, comportant notamment 365 cahiers d’acteur, bilan inédit qui montre l’intérêt porté à cette consultation.
Le gouvernement a lancé 7 mars 2025 une ultime consultation du public concernant le projet de PPE3 réputé amendé suite aux retours de la consultation publique de fin 2024. Elle vise à recueillir d'ultimes remarques avant l’adoption par décret de la version finalisée. Cependant, les délais de réponse fixés au 4 avril au plus tard sont très courts, pour une finalisation du document annoncée à partir du 7 avril. Cette précipitation ne peut qu’interroger : signifie-t-elle que la plupart des réponses ne pourront être prises en compte, en d’autres termes qu’elles n’ont pas d’importance parce que les objectifs sont en réalité déjà arrêtés ?
Pourtant, si les objectifs concernant le nucléaire et l’hydraulique sont cohérents et vont dans la bonne direction, ce n’est pas le cas de ceux qui concernent la programmation de nouveaux moyens de production éoliens et photovoltaïques, qui soulèvent de graves questions, sous plusieurs aspects :
* Ils présentent des incohérences importantes avec les objectifs contenus dans d’autre documents prévisionnels, notamment la SNBC3 ;
* Ils ne tiennent aucun compte, ni des évolutions récentes, ni des perspectives à court et moyen termes des consommations d’électricité, malheureusement très inférieures aux prévisions antérieures ; Sous cet angle, ils semblent ignorer les prévisions récentes de RTE qui travaille sur un nouveau scénario tenant compte de ces évolutions.
* Ils restent marqués par une soumission intellectuelle incompréhensible aux absurdes objectifs du « Fit for 55 », concernant notamment le taux d’énergies renouvelables à atteindre, qui n’a strictement aucun sens pour la France, dont l’électricité est déjà décarbonée à 95 % ;
* Ils sont porteurs de surinvestissements considérables, qui ont toutes chances d’être trop peu utilisés, entraînant des gaspillages financiers inacceptables.
1 - Des incohérences entre la PPE3 et la SNBC3 pour des raisons non pertinentes
Dans les documents mis en consultation fin 2024, il y a en effet une incohérence importante concernant la cible de consommation d’énergie en 2030 comme il ressort du tableau suivant (valeurs en TWh) :
|
Document |
Consommation 2023 |
Cible de consommation 2030 |
Baisse de consommation 2023 --> 2030 |
Sources |
|
PPE3 |
1 509 |
1 243 |
- 266 |
P. 344 PPE3 et P. 35 PJ1 |
|
SNBC3 |
1 509 |
1 410 |
- 99 |
P. 105 -106 SNBC3 (*) |
|
Ecart entre PPE3 et SNBC3 |
0 |
∆ = 167 |
∆ = 167 |
- |
(*) Il est certes indiqué en alinéa, page 106 : « Les trajectoires mobilisées à ce stade conduisent à une consommation d'énergie finale de la France en 2030 de 1410 TWh en intégrant un scénario de réindustrialisation » et « Des leviers complémentaires devront être identifiés et actionnés pour sécuriser l'atteinte des objectifs de réduction des consommations d'énergie ».
Mais pourquoi prendre une hypothèse différente dans les deux cas et surtout considérer qu’en cas de réindustrialisation réussie, il faudra réduire la consommation de 167 TWh dans d’autres secteurs, sans d’ailleurs préciser lesquels ? Ceci alors que réindustrialiser doit essentiellement se faire à partir d’une électricité déjà bas carbone, gage de fabrications françaises ayant un bilan carbone très inférieur aux fabrications importées. Réindustrialiser est dans ce conditions vertueux pour le climat !
Quel improbable objectif de consommation faut-il alors satisfaire, sinon une improbable extrapolation d’une courbe technocratique, au prix de la désindustrialisation ?
Rappelons que les seuls véritables « ennemis » sont le CO2 et les énergies fossiles qui l’émettent, pas l’énergie en tant que telle si elle est décarbonée et crée de la richesse en France, dont le pays aura bien besoin pour financer la transition énergétique qui est extrêmement coûteuse en investissements.
2 - Des surinvestissements très importants en moyens de production éoliens et photovoltaïques sans débouchés prévisibles assurés à ce jour
L’année 2024 a confirmé une consommation stagnante et révélé un surplus considérable de production d’électricité à hauteur de 89 TWh nets, qui ont été exportés. De plus, les perspectives d’augmentation de la consommation d’électricité dans les années à venir sont malheureusement limitées, eu égard : à la stagnation de l’industrie dont l’électrification ne démarre pas ; à la panne de la filière hydrogène décarboné, qui a pris beaucoup de retard et est soumise à de nombreuses incertitudes ; à la panne de croissance des ventes de voitures électriques en 2024 ; à la panne des ventes de pompes à chaleur, qui ont fortement baissé en 2024 et ont été remplacées par des chaudières au gaz à condensation qui vont être utilisées pendant au moins une quinzaine d’années. Seule exception en vue à ce jour : la croissance annoncée des datacenters, qui pourraient consommer jusqu’à 30 TWh/an dans un avenir assez proche. Mais cela ne suffira pas à compenser la faible croissance des secteurs précités.
La conséquence est claire : le surplus d’électricité décarbonée considérable de 89 TWh dont on a disposé en 2024 mettra du temps à se résorber et il y a mieux à faire que de continuer à l’exporter massivement à un prix moyen de ≈ 56 €/MWh très peu rémunérateur. Cela confère au pays une marge de croissance de la consommation très importante.
Or, le projet de PPE3 amendé prévoit toujours de multiplier globalement les puissances installées en éolien à terre, éolien en mer et photovoltaïque par ≈ 2,2 d’ici 2030 et par 2,9 à 3,3 d’ici 2035. Maintenir des investissements aussi élevés en éolien, surtout éolien en mer qui est extrêmement coûteux et en photovoltaïque dans un contexte de surproduction est prendre le risque majeur de surinvestissements considérables, y compris en réseaux nécessaires pour acheminer ces nouvelles productions, qui seront massivement sous-utilisés et pèseront en outre sur la rentabilité des moyens existants. Au total, ce sont des dizaines de milliards d’euros qui risquent fort d’être investis prématurément à contre-emploi. Ceci sans parler de leurs effets négatifs sur la sécurité de fonctionnement du réseau et l’économie globale du système électrique.
En effet, il est totalement certain que des capacités de production supplémentaires sans débouchés vont augmenter considérablement les occurrences de prix négatifs sur le marché de l’électricité, avec pour conséquence de dé-rentabiliser l’ensemble des moyens de production, existants et nouveaux. De plus, en été lorsque la consommation est faible et le soleil puissant, il n’y aura pas d’autre solution pour protéger la stabilité du réseau que d’écrêter très sévèrement la production photovoltaïque qui n’aura aucun débouché à la bonne échelle. Ceci pratiquement tous les jours entre ≈ 10h et ≈ 16h, mettant en cause le modèle économique de cette production. Et qui paiera cette destruction de valeur ? Ne doutons pas un instant que ce sera le consommateur final, au travers de sa facture d’électricité !
Dans ces conditions, une programmation de nouveaux moyens de production éoliens et photovoltaïques selon un calendrier rigide préconçu comme celui de la PPE3 n’a aucun sens. Il est indispensable, pour ces moyens de production, surtout le photovoltaïque, à délais de construction physique relativement courts, d’adopter une programmation adaptative collant au plus près aux consommations réelles constatées et à leur évolution prévisible, après avoir utilisé les surplus d’électricité décarbonée existants qui devraient s’atténuer progressivement d’ici 2030, voire un peu au-delà.
3 - Une absence de coordination avec les données des Bilans prévisionnels de RTE qui interroge
Les Bilans prévisionnels (BP) de RTE sont une donnée d’entrée majeure de l’établissement de la PPE et de la SNBC, l’électricité étant le vecteur énergétique dominant de notre avenir énergétique.
Tout laisse donc à penser que l’élaboration des projets de PPE3 et SNBC3 mis en consultation fin 2024 ont logiquement été basés sur les prévisions de RTE existantes à date. Le projet définitif de PPE3 mis en consultation le 7 mars 2023 ayant repris sans changements notables l’essentiel des données de la PPE3 de fin 2024, il reste de facto basé sur des prévisions de RTE non actualisées datant de 2024.
Pourtant, RTE a depuis travaillé sur le BP 2025-2035 qui a fait l’objet d’un premier Groupe de Travail (GT) public début février 2025, suivi d’une consultation lancée le 18 mars qui terminera le 8 avril. Point important, ce projet de BP 2025-2035 intègre un nouveau scénario dont l’objet est justement de prendre en compte les dernières tendances de consommation observées et anticipées, selon sa dénomination parfaitement explicite : « Scénario D : faible augmentation de la consommation, basée sur une analyse des tendances récentes ».
Le BP 2025-2035 complet doit donner lieu à de nouveaux GT d’ici l’été 2025 et ne sera officiellement publié que fin 2025. Mais de premières tendances concernant le scénario D devraient être disponibles courant avril 2025, suite au retour de la consultation publique précitée de RTE. Ces tendances pourraient donc être connues peu de temps après la publication de la PPE3 et éclairer les trajectoires de cette dernière avec des données actualisées structurantes, qui consolideraient les bases d’une PPE3 collant à au mieux la réalité qui a profondément changé depuis les estimations précédentes. Mais rien de tel ne semble prévu.
On ne peut que s’étonner de cette précipitation à publier la PPE3, ignorant des informations récentes susceptibles d’entraîner des conséquences majeures. Ou bien est-on dans une programmation de nature bureaucratique ne tenant pas compte des réalités, au risque de gaspiller des dizaines de milliards d’euros dans des investissements prématurés inutiles à court terme ?
4 - Il est urgent de sortir de la soumission aux injonctions hors-sol de la Commission européenne
Il est devenu évident que les objectifs du « Fit for 55 » sont inatteignables. Faut-il s’en étonner ? Ils ont été décidés au « doigt mouillé » sans aucune étude d’impact, dans une crise de « pensée magique » qui consiste à croire qu’il « suffit » de publier un objectif pour qu’il soit atteint. Aucun des États membres n’a su ou voulu s’y opposer, sans doute au nom d’une molle unanimité politiquement correcte. Et le Parlement européen, peuplé d’une majorité de députés peu au fait des réalités, a sans doute approuvé ces objectifs, voire en a demandé plus. Mais la réalité finit toujours par s’imposer, et cette échéance s’approche à grands pas. Un aggiornamento général est donc inéluctable à court terme. Mais personne ne semble avoir le courage de le reconnaître publiquement le premier…
Repartir sur des objectifs climatiques réalistes et rationnels, qui auront des chances d’être atteints dans des conditions économiques supportables est pourtant devenu indispensable.
Dans ce contexte, une injonction européenne atteint le comble de l’absurde, appliquée à la France : l’obligation d’atteindre 45 % d’énergies renouvelables en 2030 dans le mix électrique. Cela n’a aucun sens pour la France, dont l’électricité est déjà décarbonée à 95 % grâce au nucléaire majoritaire, à l’hydraulique et à la contribution de l’éolien et du photovoltaïque. Les gouvernements français successifs récents se sont d’ailleurs opposés à juste raison à cette absurdité.
Plus globalement, la politique énergétique de la France doit être profondément repensée en fonction de ses intérêts majeurs, en se dégageant des injonctions technocratiques de la Commission qui y sont profondément contraires. La PPE3, censée s’appliquer pour les cinq années à venir, devrait donc refléter cette orientation stratégique nationale, qui relève du droit de chaque pays, reconnu par les Traités européens, à décider souverainement de son mix énergétique. Ce droit est supérieur aux improbables injonctions de la Commission, fussent-elles avoir été acceptées par la France lors de consensus mous passés. Les erreurs doivent être reconnues pour ce qu’elles sont et corrigées.
C’est d’autant plus indispensable que la Commission européenne s’est disqualifiée en prônant une politique énergétique alignée sur celle de l’Allemagne qui est un désastre absolu, à la fois climatique et économique, devenu évident aux yeux de tous ceux qui veulent bien regarder la réalité en face.
Persister à vouloir étendre ce contre-modèle avéré à l’Europe entière est une folie pour la future sécurité d’alimentation en électricité du continent. Malheureusement, la Commission continue à tout faire pour freiner le développement de nouveaux moyens nucléaires : la première vice-présidente exécutive de la Commission, Teresa Ribera, anti-nucléaire notoire en charge à la fois de la « transition propre, juste et compétitive » et de la concurrence, vient de justifier « l’absence de cadre pour les aides d’État visant le nucléaire » en ajoutant « nous procédons à une évaluation au cas par cas et allons continuer à le faire ».
Il ne fait aucun doute que la France est visée et que le financement des 6 premiers EPR2 va en être freiné et complexifié. C’est inacceptable, la neutralité technologique qui devrait être la règle concernant les moyens de production d’électricité décarbonée et est d’ailleurs reconnue dans d’autres domaines, comme la production d’hydrogène électrolytique, est une nouvelle fois bafouée.
5- Pour conclure
La situation actuelle du pays est caractérisée par : une stagnation de la consommation d’électricité qui devrait perdurer un certain temps ; un surplus très important de production d’électricité qui ne devrait se résorber que progressivement ; des contraintes de financement majeures dans tous les domaines pour le pays, qui excluent absolument tout risque de gaspillage.
Dans ce contexte, la solution de loin la plus efficace pour réduire les émissions de CO2 au moindre coût n’est certainement pas de surinvestir prématurément et selon une programmation rigide dans de nouveaux moyens de production éoliens et photovoltaïques sans débouchés prévisibles à ce jour. Ces investissements doivent au contraire être faits en relation étroite avec les consommations réellement constatées et leurs évolutions prévisionnelles régulièrement actualisées.
Les fonds ainsi économisés sur d’inutiles productions pourraient alors être transférés aux aides aux usages de l’électricité décarbonée déjà disponible en abondance. Trois domaines, les plus émetteurs de CO2, pourraient en bénéficier en priorité :
* La mobilité, dont l’électrification a baissé en 2024 et n’est pas sur une pente de croissance suffisante, notamment pour des raisons de prix trop élevés des voitures électriques. Des aides financières accrues et non pas réduites comme c’est le cas en 2025, iraient dans la bonne direction. On notera en outre que remplacer une voiture thermique par une voiture électrique, non seulement élimine pratiquement les émissions de CO2 en circulation, mais divise par près de 3 la consommation d’énergie finale et réduit les importations de pétrole. C‘est un triple bénéfice.
* L’habitat, dans lequel les achats de pompes à chaleur (PAC) ont fortement baissé en 2024. Là encore, leur coût d’investissement, très supérieur à celui des chaudières à condensation au gaz, est un frein très important, qui pourrait être desserré par des aides financières accrues. Et comme dans le cas de la mobilité, remplacer une chaudière au gaz par une PAC divise par 3 la consommation d’énergie finale et réduit les importations de gaz. Mais il faudrait en outre modifier la RE2020 qui continue absurdement à prendre en compte l’énergie primaire. Cela n’a plus aucun sens, ni physique ni économique avec une électricité quasi-décarbonée qui se retrouve abusivement et absurdement défavorisée au bénéfice du gaz.
* L’industrie, dont la décarbonation par l’électrification des processus est beaucoup plus complexe et pour laquelle le prix de l’électricité et sa stabilité à long terme sont des facteurs déterminants. Cette électrification est aussi plombée par le contexte actuel d’incertitudes politiques et économiques. Le prix de l’électricité est cependant le souci principal pour la plupart des entreprises et pose la question de sa taxation sous forme d’accise. À l’exception des entreprises électro-intensives qui bénéficient d’une accise fortement réduite, l'électricité bas carbone utilisée par le reste de l’industrie (et par les consommateurs domestiques, ne les oublions pas…), supporte en effet une accise pratiquement deux fois plus élevée, à 33,70 €/MWh, que le gaz fossile émetteur de CO2, à 17,16 €/MWh !
Sauvons le Climat a déjà dénoncé, dans son communiqué du 20 février 2025, cette anomalie qui constitue une double erreur : d’abord pour le climat, ensuite pour la balance commerciale, l’électricité étant produite quasi-nationalement et le gaz étant importé.
Les sommes économisées dans le report d’investissements prématurés et précités pour de nouveaux moyens de production éoliens et photovoltaïques seraient beaucoup plus utiles et bénéfiques dans la réduction de l’accise sur l’électricité, la réduction du prix de cette dernière ayant un effet de levier positif majeur sur l’ensemble de l’économie du pays et sur sa compétitivité.
En conclusion, pour toutes les raisons explicitées ci-dessus, Sauvons le Climat considère que le projet de PPE3 mis en consultation est, dans son état actuel, gravement contre-productif pour lutter contre le réchauffement climatique pour plusieurs raisons dont les conséquences s’enchaînent : (1) il se trompe de priorités à court terme et probablement pour au moins les 5 ans à venir. Il ne s’agit en effet pas de produire davantage d’électricité décarbonée mais de favoriser l’usage de celle qui est déjà disponible en abondance ; (2) il présente un risque majeur de gaspillage d’argent rare et cher qui serait beaucoup plus utile pour favoriser l’électrification des usages ; (3) l’électricité éolienne et photovoltaïque ayant toutes chances de continuer à devoir être subventionnée pour exister, les surinvestissements inutiles dans ces secteurs seraient in fine payés par les consommateurs, qui verraient leurs factures d’électricité augmenter et limiteraient en réaction leurs consommations, aggravant la situation actuelle ; (4) le processus de décarbonation de l’économie par l’électrification des usages en substitution aux consommations énergétiques fossiles en serait fortement ralenti ; (5) les objectifs de neutralité carbone seraient gravement retardés.
Le nucléaire n’est évidemment pas concerné par cette problématique. D’abord, parce qu’il n’y aura pas d’augmentation de la puissance nucléaire installée avant 2038 (cible de mise en service du 1er EPR2) ensuite et surtout parce qu’il s’agit d’une technologie indispensable pour garantir un socle de production d’électricité décarbonée, pilotable et compétitive, seul à même d’assurer la sécurité d’alimentation et la souveraineté du pays dans le long terme. Il s’agit de pérenniser l’option nucléaire en prolongeant les réacteurs actuels et en les complétant par de nouveaux réacteurs qui les remplaceront progressivement quand ils arriveront en fin de vie, processus s’inscrivant dans le très long terme.
Dans cette optique et face à ce programme industriel majeur, il est essentiel que l’industrie nucléaire dispose dès que possible d’une visibilité à long terme concernant sa charge de travail afin de s’organiser de façon optimale. La PPE3 apporte sur ce point une programmation très positive avec l’ACTION NUC.4 destinée à approfondir les objectifs permettant de prendre d’ici 2026 la décision d’un second palier d’au moins 8 réacteurs EPR2, signal majeur donnant la visibilité nécessaire à l’industrie nucléaire.
D’autres points vont dans la bonne direction et méritent d’être soulignés : l’ACTION NUC.5 concernant le développement des petits réacteurs innovants (SMR et AMR) et l’ACTION NUC.7 visant à définir une nouvelle feuille de route concernant la mise en œuvre d’un futur parc de RNR. Le dernier Conseil de politique nucléaire du 17 mars vient d’ailleurs de confirmer cette dernière orientation.
Copyright © 2025 Association Sauvons Le Climat