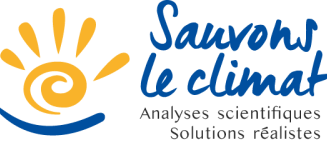Voici un an, dans son communiqué du 7 avril 2024 intitulé : LA FRANCE « SUR LES RAILS » POUR TENIR SES OBJECTIFS DE CO2 : VRAIMENT ? Sauvons le climat questionnait la vision optimiste du gouvernement se félicitant d’une réduction en 2023 d’environ 4,8 % des émissions de CO2e (CO2 dit équivalent, incluant l’ensemble des gaz à effet de serre) par rapport à 2022.
Une analyse sectorielle mettait en effet en évidence que cette réduction importante résultait majoritairement de deux causes conjoncturelles : d’abord d’une très forte hausse de la production d’électricité nucléaire, pour environ 1,8 %, ensuite d’une baisse de l’activité industrielle, ayant entraîné une moindre consommation de gaz selon l’analyse du CITEPA, pour environ 1,5 %.
Ne restait dans ces conditions que 4,8 - 1,8 - 1,5 = 1,5 % de réduction attribuable à des causes structurelles, c’est-à-dire en principe définitivement acquises. Trop peu…
Qu’en est-il pour 2024 ? Le CITEPA a publié ses pré-estimations le 28 mars dernier. Hors puits de carbone, les émissions de CO2e ont globalement diminué d’environ 373 à 366 Mt entre 2023 et 2024, soit une réduction d’environ 7 Mt en 2024, plus précisément de 6,7 Mt, soit de 1,8 % répartis sectoriellement comme suit :
* 3,7 Mt pour la production d’électricité, représentant ≈ 1 % du total ;
* 1,1 Mt pour l’industrie, représentant ≈ 0,3 % du total ;
* 1,1 Mt pour les transports, dont 1 Mt pour les transport routiers et 0,1 Mt pour l’aviation, représentant ≈ 0,3 % du total ;
* 0,6 Mt pour l’habitat-tertiaire, représentant un peu moins de 0,2 % du total.
La structure de ces résultats les rend globalement très insuffisants car elle traduit une évolution structurelle tendancielle largement insuffisante. En effet :
* La principale réduction des émissions provient à nouveau de la production d’électricité. Elle est due à une nouvelle augmentation de la production d’origine nucléaire, doublée d’une production d’électricité d’origine hydraulique exceptionnellement élevée. Cette réduction très importante est non seulement conjoncturelle, mais elle ne se reproduira pas à ce rythme en 2025 et au-delà, la production nucléaire étant appelée à croître plus lentement dans les années à venir du fait des lourds programmes de « grand carénage » en cours qui brident temporairement sa production. Quant à la production hydraulique, elle est soumise aux aléas de la pluviométrie. Néanmoins, 89 TWh d’électricité ont été exportés en 2024, traduisant l’abondance de l’électricité décarbonée disponible, qui aurait été beaucoup plus utile si elle avait décarboné l’économie française.
* La baisse des émissions de l’industrie est, selon le CITEPA, en partie liée à la baisse de la fabrication de matériaux de construction pour le logement, secteur en panne en 2024. Difficile dans ces conditions d’y voir autre chose qu’une baisse essentiellement conjoncturelle dont la cause est tout à fait regrettable.
* Les deux autres secteurs parmi les plus émetteurs, les transports et l’habitat-tertiaire, affichent à eux deux une baisse cumulée de leurs émissions d’environ 0,5 % qui peut être considérée comme structurelle. Mais elle est très faible, très proche de la stagnation. Le CITEPA l’explique par l’insuffisance des ventes de voitures électriques et par la baisse des rénovations énergétiques des bâtiments et la chute du développement des pompes à chaleur. Des températures moyennes légèrement plus douces en 2024 qu’en 2023 soulignent en outre la fragilité de ces estimations.
Ces résultats globaux extrêmement médiocres pour 2024 en dépit de l’abondance d’une électricité décarbonée à 95 % ont une cause commune : la panne de l’électrification des trois secteurs précités les plus émetteurs de CO2e (industrie, transports et habitat-tertiaire). Favoriser l’usage de l’électricité dans ces trois secteurs est donc l’action efficace à engager en priorité si l’on veut réduire les émissions du pays.
Comment ? D’abord en baissant les taxes (accise) sur sa consommation, ces taxes étant deux fois plus élevées pour les consommateurs domestiques que celles appliquées au gaz (voir communiqué de Sauvons le climat du 25 février 2025 intitulé : Taxer l’électricité : un contre-sens pour le climat). Un prix de l’électricité compétitif et prévisible vaut pour tous les secteurs, mais tout particulièrement pour déclencher le choix de l’électrification dans l’industrie et l’artisanat.
Ensuite, dans les deux secteurs directement soumis aux choix des citoyens-consommateurs, la mobilité individuelle et l’habitat, en favorisant les aides à l’achat des voitures électriques et à la rénovation des logements, incluant l’achat de pompes à chaleur, beaucoup plus chères en investissement que les chaudières au gaz. Tout cela en simplifiant et stabilisant en outre les modalités de ces aides qui, en changeant fréquemment chaque année, deviennent illisibles et dissuadent les consommateurs.
Reste enfin une épreuve de vérité : reconnaître que les objectifs technocratiques du « Fit for 55 » européen pour 2030, dont l’échéance est dans moins de 5 ans, sont inatteignables et réoptimiser en conséquence la trajectoire de baisse des émissions de la France en fonction de ses réalités propres et de ses intérêts supérieurs.
Il est en effet impensable de gaspiller un argent rare et cher dans des investissements qui ne contribueraient pas à une réduction efficace et rapide des émissions du pays. Ce sujet majeur a été abordé dans le communiqué de Sauvons le climat du 31 mars 2025 intitulé : NOTRE CONTRIBUTION A L’ENQUETE DU GOUVERNEMENT SUR LA PPE3, et approfondie dans la note associée : COMMENTAIRES DE SAUVONS LE CLIMAT SUR LE PROJET DE PPE3.
Références : Baromètre du Citepa : première estimation des émissions sur l’ensemble de l’année 2024 et CP-Citepa_Barometre_28mars2025_final.pdf
Copyright © 2025 Association Sauvons Le Climat