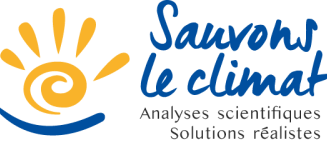Henri Prévot le 10 mai 2012
Présentation de Avec le nucléaire – un choix réfléchi et responsable
Seuil, 2012
Pour produire de l’électricité, au nom de quoi courir le risque nucléaire ?
A cette question deux réponses faciles : ou bien considérer que le risque est tellement improbable que ce n’est pas la peine d’y penser ; ou, tout au contraire, répondre que les dommages sont tellement graves que le risque est inacceptable, aussi faible soit sa probabilité.
Avec le nucléaire refuse ces deux réponses et commence en passant les risques en revue.
Il montre que les déchets nucléaires, comme ils sont gérés en France, ne présentent pas de risque.
Le risque d’un grave accident nucléaire ne peut pas être complètement exclu. Pour débattre sérieusement de la question, il faut un minimum de technique. Avec le nucléaire présente de façon accessible aux non spécialistes les causes possibles d’un grave accident et les précautions prises pour l’éviter. Les conséquences de l’accident de Fukushima auraient été beaucoup moins graves si l’exploitant avait seulement tiré les enseignements d’un accident survenu aux Etats-Unis. La radioactivité émise à la suite d’un grave accident retombe sur le sol. Si les doses reçues par un organisme vivant sont faibles, leur effet sur la santé, s’il y en a un, est indécelable.
La catastrophe de Fukushima nous montre que le nombre de décès causés par un très grave accident peut être réduit à très peu de chose – incomparablement moins que les morts causées par l’exploitation et la consommation de charbon, des morts que le nucléaire, remplaçant des centrales au charbon, permet à coup sûr d’éviter. Mais un grave accident rend inhospitalières ou inhabitables de grandes étendues qu’il faut plusieurs années pour pourvoir habiter de nouveau. Ce risque ne doit pas être minimisé.
Si l’on refuse absolument le risque d’un grave accident nucléaire, aussi faible soit sa probabilité, il est inutile de comparer avantages et inconvénients du nucléaire. Le seul but qui vaille est d’arrêter toute production et toute consommation d’électricité nucléaire. C’est techniquement possible. Il suffit de produire beaucoup d’électricité à partir du vent et du soleil, de stocker le gaz carbonique, de diminuer la consommation d’énergie en renonçant à des déplacements et en isolant tous les bâtiments existants, de diminuer la consommation d’énergie par l’industrie. Comme le refus du risque nucléaire est absolu, il est inutile de calculer le coût d’une telle politique. Inutile également d’en évaluer les conséquences sur les émissions de CO2, sur l’activité économique, sur notre autonomie énergétique.
Si le risque d’un grave accident nucléaire n’est pas refusé par principe, on cherchera quelle est la capacité de production nucléaire optimale. On évaluera donc les avantages et les inconvénients de plus ou moins de nucléaire. Il ne suffit pas de calculer les coûts de production, de consommation et d’économie d’énergie, mais on ne peut pas s’en passer.
Avec le nucléaire présente les composantes du coût de la production d’électricité nucléaire (à partir du rapport de la Cour des Comptes), le coût des éoliennes et du photovoltaïque en tenant compte du fait que ces productions ne peuvent pas être commandées en fonction de la demande d’électricité, le coût de production des autres formes d’énergie (biomasse, etc.), le coût des économies d’énergie. Puis sont présentées trois hypothèses : la capacité nucléaire reste égale à ce qu’elle sera après le démarrage de l’EPR de Flamanville, ou sera augmentée de façon à réduire autant que possible les dépenses, ou sera diminuée d’un tiers pour que la production nucléaire soit la moitié de la consommation d’électricité.
Comparée à la solution la moins coûteuse, la stabilisation de la capacité nucléaire coûterait environ 10 milliards d’euros par an de plus ; la réduction de la capacité nucléaire coûterait environ 30 milliards d’euros par an de plus.
Le détail des calculs est exposé en annexe de Avec le nucléaire ou sur un site Internet où des feuilles de calcul permettent à chacun d’introduire ses propres hypothèses tant sur les quantités produites et consommées que sur le prix de l’énergie et le coût des économies d’énergie : http://www.hprevot.fr/AvNucl.html.
Dans l’hypothèse la moins coûteuse, l’électricité est produite à plus de 80 % par des centrales nucléaires. Une capacité éolienne ou photovoltaïque très limitée est prévue, non pour produire de l’électricité, mais pour permettre à nos entreprises voulant exporter sur des marchés mondiaux où la production nucléaire est impossible ou insuffisante de démontrer leur savoir-faire.
Cette forte proportion de production nucléaire soulève des questions auxquelles répond Avec le nucléaire. En voici deux.
- Ne serait-il pas préférable de réduire la capacité nucléaire pour réduire le risque de grave accident ? Il n’est pas sûr que le fait de diminuer le nombre de réacteurs réduise le risque car une plus grande capacité nucléaire diminuerait la pression sur la production. Mais ce n’est pas la bonne réponse à la question posée. Si le risque nucléaire n’est pas refusé par principe, un réacteur en plus, ce sont des émissions de CO2 en moins, c’est une moindre dépendance à l’égard de la Russie et bien d’autres avantages qui compensent au centuple et davantage le coût probable d’un très grave accident nucléaire.
- Ne serait-il pas préférable de diversifier la production d’électricité pour renforcer la sécurité d’approvisionnement (« ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ») ? Avec le nucléaire apporte une réponse nouvelle à cette question en recommandant le développement non seulement des véhicules hybrides mais aussi du « chauffage hybride » utilisant indifféremment de l’électricité et une autre forme d’énergie, fioul ou gaz. La sécurité d’approvisionnement en électricité est alors remplacée par la sécurité d’approvisionnement en énergie, une question à laquelle il est facile de répondre puisque l’autre forme d’énergie (liquide ou gaz) se stocke facilement. Il n’y a plus de problème de pointe de consommation d’électricité et une dizaine de réacteurs nucléaires pourrait devenir indisponible en même temps et sans préavis sans que les consommateurs qui ont besoin d’électricité soient gênés.
En somme, refuser un réacteur nucléaire dans une centrale, c’est courir moins de risque à proximité de cette centrale, ce qui répond à un réflexe NIMBY (« not in my backyard », « pas dans mon arrière-cour »), légitime et plutôt égoïste. Un réacteur nucléaire de plus, c’est créer un risque dont la probabilité est extrêmement faible, et c’est économiser un milliard d’euros par an de dépenses pour produire, consommer ou économiser l’énergie, c'est-à-dire avoir plus de pouvoir d’achat ou financer plus d’enseignants, de chercheurs ou de policiers ; c’est aussi moins de CO2 donc moins de dommages dans les pays qui auront peu de moyens de réagir au réchauffement climatique ; c’est aussi une plus grande autonomie vis-à-vis des pays producteurs de gaz ou de pétrole ; c’est moins d’importation ; c’est une énergie moins chère pour notre industrie dans une compétition mondiale féroce ; c’est la présence de la France parmi les producteurs d’énergie dans un monde qui aura de plus en plus faim d’énergie.
L’ingénieur, l’économiste et le politique
Avec le nucléaire présente des réflexions d’ingénieur et d’économiste. Il appartient au politique de décider.
Un des aspects du rôle du politique est de maintenir la paix civile. Pour éviter ou minimiser les désordres, il lui suffit de connaître le désir des citoyens, leur capacité d’action et leur détermination. A l’égard de ceux dont il n’est pas possible de satisfaire la demande, il sera parfois suffisant de faire un geste de reconnaissance. Il est alors inutile de connaître les aspects techniques et économiques en cause, ce qui permet de ne pas en connaître le coût. Dans ce cas, le politique évite normalement de s’appuyer fautivement sur des arguments prétendument techniques pour justifier une décision politique.
Le politique est par ailleurs responsable de la sécurité générale du pays, de son avenir à long terme, de son indépendance ; pour atteindre ces objectifs, il recherche et met en œuvre les méthodes qui respectent autant que possible la liberté individuelle, c’est à dire les moins coûteuses. Alors, il doit connaître les aspects techniques et économiques des matières en cause.
C’est dans cette perspective qu’a été rédigé Avec le nucléaire.
Avec le nucléaire présente d’abord les aspects techniques (le fonctionnement des réacteurs, les risques d’accident, les effets sanitaires de la radioactivité, la gestion des déchets, les réacteurs du futur, la place du nucléaire dans le double défi du développement et du réchauffement climatique), puis pose la question « continuer ou s’arrêter ? », puis compare des jeux d’hypothèses avec plus ou moins de nucléaire et finit en abordant la question « Au nom de quoi accepter le risque nucléaire ».
Chaque chapitre est précédé d’un chapeau qui en résume le contenu. Des compléments sont apportés sur http://www.hprevot.fr/AvNucl.html.